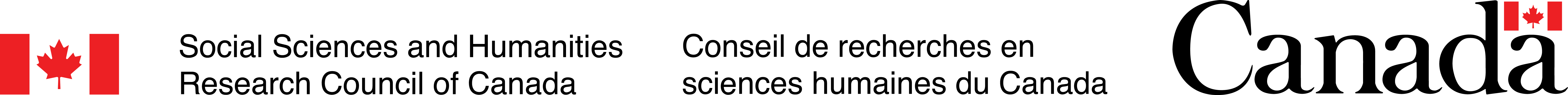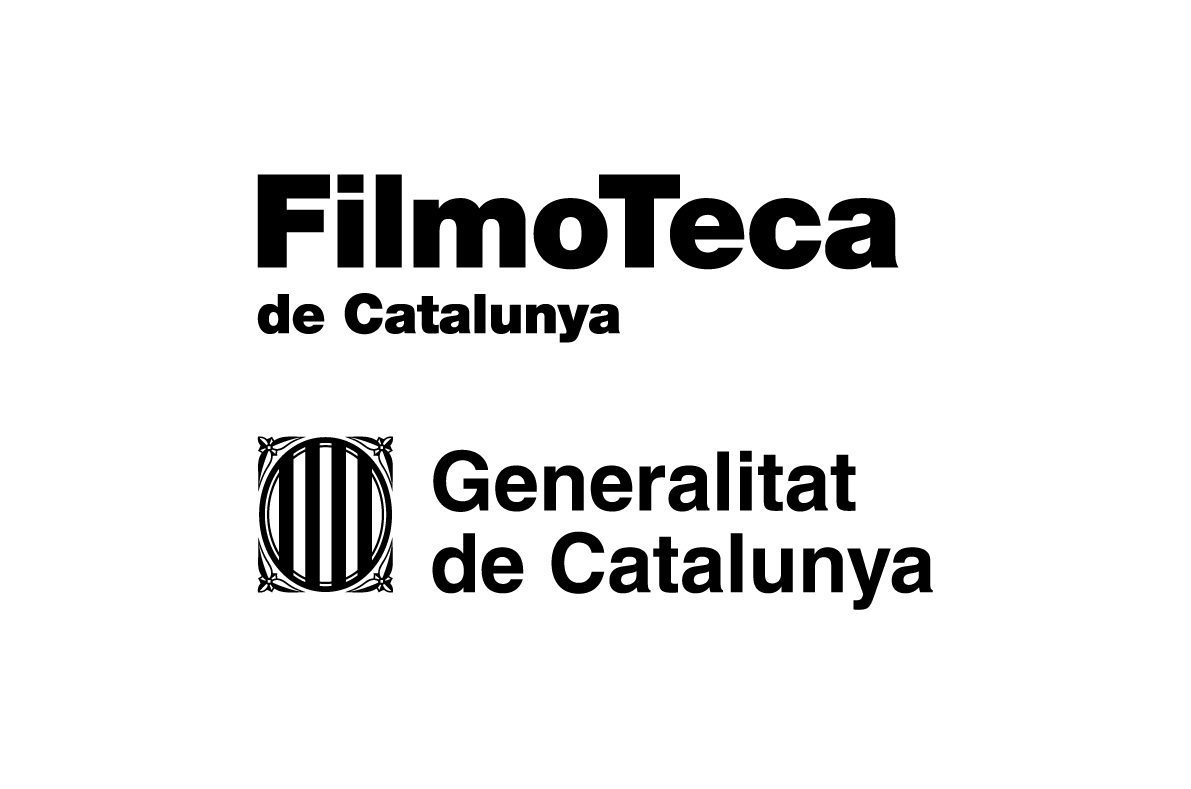Les Brigades internationales
Creator: 11ª Brigada Internacional. Banda de Música
Source:
Centro Documental de Memoria Histórica,
https://www.cultura.gob.es/dam/jcr:7bab8fc1-5bf2-4346-80b6-3991829d5b72/brigadas-audio.mp3
Date Created: 1937
Type: Sound recordings
Extent: 1 item
Cette chanson est l’hymne des Brigades internationales chanté par le chœur de la 11e Brigade internationale dirigé par l'acteur, chanteur et volontaire allemand Ernst Busch.
Le 18 septembre 1936, le Komintern, l'organisation des partis communistes contrôlée par Moscou, décide de créer les Brigades internationales. L'idée est d'aider la République en envoyant des volontaires. Des centaines d'étrangers se battent déjà spontanément en Espagne, mais plusieurs milliers d'autres veulent se joindre au combat. Certains sont des intellectuels, mais la plupart sont des ouvriers. La plupart étaient communistes, mais les convictions politiques des bénévoles variaient, y compris un antifascisme général. Certains se sont même engagés par goût de l'aventure. Le 14 octobre, les Brigades sont officiellement constituées. Leur chef, nommé par les Soviétiques, est le communiste français André Marty. Stalinien convaincu et disciplinaire impitoyable, il sera accusé d'avoir ordonné l’exécution de centaines de membres des Brigades.
Les Brigades au nombre de sept (XI à XV, 129 et 150), ont enrôlé environ 35 000 soldats originaires de plus de 50 pays. Chacune était composée d'environ 2 000 hommes répartis en trois, voire quatre bataillons, souvent regroupés en fonction de leur nation d'origine (bien qu'avec le temps, des soldats espagnols aient également été enrôlés dans les Brigades). La plupart d’entre eux n’avaient aucune expérience militaire, mais beaucoup étaient des vétérans de la Première Guerre mondiale. La France a fourni de loin le plus grand nombre de brigadistes, environ 10 000, suivie par les exilés d'Allemagne et d'Autriche, et par l'Italie.
Les brigadistes ont été utilisés comme force de choc dans les batailles les plus difficiles de la guerre, de la défense de Madrid en novembre 1936 à la traversée de l'Èbre en juillet 1938. En conséquence, leur nombre de victimes a été très élevé, environ 30% des troupes, alors que la moyenne pendant la Guerre Civile espagnole était d'environ 10%. Les pertes les plus lourdes ont été enregistrées lors de l'effondrement du front aragonais, qui a débuté en mars 1938.
Les franquistes avaient l'habitude de fusiller les brigadistes, bien que par la suite, en partie sous la pression de leurs alliés italiens et allemands, ils aient commencé à les échanger contre des prisonniers. Les brigadistes capturés ont fini par être entassés dans le tristement célèbre camp de concentration de San Pedro de Cardeña, à Burgos, dans des conditions épouvantables.
Des foules immenses ont acclamé les Brigades internationales lors de leur défilé d'adieu à Barcelone le 28 octobre 1938. Leur sort ultérieur a été très variable. Les Français, les Britanniques et les Américains n'ont eu aucun mal à se réinsérer dans la vie civile. D’autres, en revanche, comme les Suisses et les Canadiens, ont été persécutés par leurs gouvernements démocratiques, comme l’ont été ceux qui provenaient de pays gouvernés par des dictatures. Les Allemands, Autrichiens et Italiens n'avaient nulle part où aller. La plupart d’entre eux, après être passés dans les camps d’internement français, ont continué la lutte contre le fascisme pendant la Seconde Guerre mondiale.
De même, la manière dont on se souvient d’eux dans leurs pays d’origine a varié et a évolué au fil du temps pour refléter l’évolution des circonstances politiques.