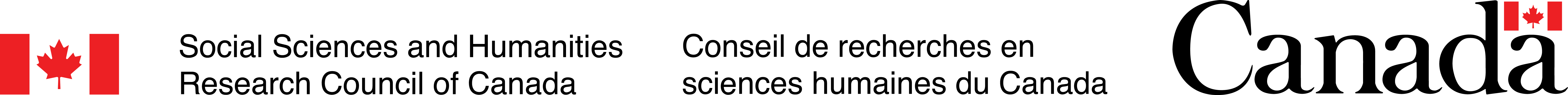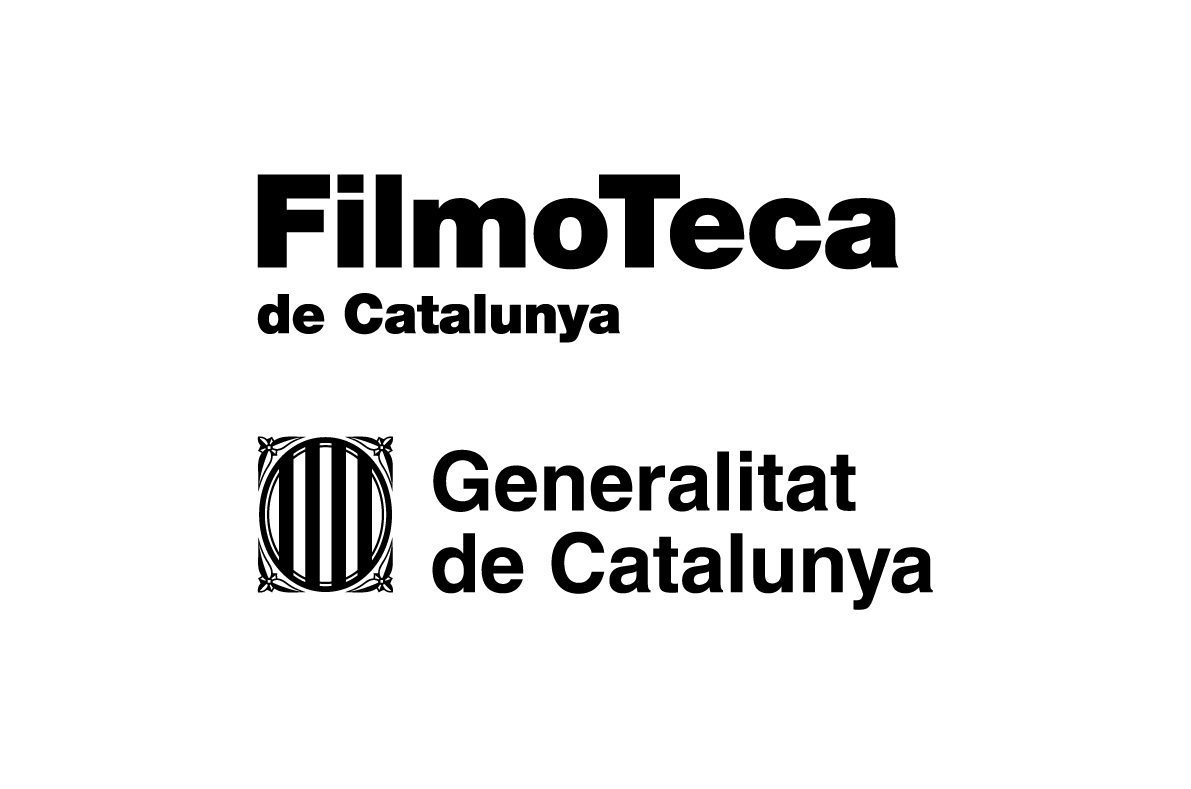L’Organisation Syndicale
Creator: Central Nacional Sindicalista
Source:
Public Domain, https://es.wikipedia.org/wiki/Sindicato_Vertical#/media/Archivo:Carnet_de_la_CNS_1939.png
Date Created: 1939
Extent: 1 item
39.46971, -0.37634
Ceci est une carte de la « Central Nacional Sindicalista » (appelée « Organización Syndical » depuis 1971), le syndicat vertical du régime franquiste.
Le syndicat vertical était l'instrument par lequel l'encadrement des travailleurs et des employeurs et la politique sociale du régime franquiste devaient être menés à bien. Il devait également imposer une discipline aux éléments qui participaient à la production et devait aussi mener à bien la « révolution syndicale nationale ». La création, en janvier 1938, d'un ministère de l'Organisation et de l'Action syndicales semble donner la prépondérance aux thèses phalangistes. Cependant, Franco place à sa tête un ancien haut fonctionnaire de la dictature de Primo de Rivera. L'attitude des élites traditionnelles - traditionalistes, catholiques et oligarchie économique - s’oppose aux projets fascistes.
La loi sur l'unité syndicale et la loi sur les bases de l'organisation syndicale, promulguées en décembre 1940, définissent la structure des syndicats nationaux. Ceux-ci étaient spécialisés selon les branches de production. Alors qu'en théorie, tout le monde soit sensé adhérer aux syndicats, en réalité, l'affiliation est restée assez flexible en raison des pressions exercées par le corporatisme catholique et le traditionalisme. Les données relatives aux affiliations montrent l'apathie des travailleurs envers les politiques franquistes. Entre 1940 et 1945, le nombre d'adhérents est passé de 2 000 000 à environ 3 900 000. Toutefois, à partir de la seconde moitié des années 1940, ce chiffre stagne à 4 millions et, par la suite, le taux de croissance annuel est d’environ 1 %.
Les deux lois susmentionnées étaient fondées sur le principe de l'unité. Celui-ci est déployé dans un double sens. D'une part, il rejette le pluralisme syndical en interdisant toute autre organisation syndicale. D’autre part, il oblige les employeurs et les travailleurs - les « producteurs » - à s’intégrer de manière harmonieuse dans les syndicats nationaux. Ce dépassement de la lutte des classes se fait sur le papier, mais pas dans la pratique. Au sein de chaque syndicat, deux sections sont reconnues : la section économique - celle des employeurs - et la section sociale - celle des travailleurs.
Le point de départ de toute la structure syndicale franquiste était l'entreprise. C’est le point de départ de la syndicalisation. Cette incorporation a lieu dans toutes les entreprises, qu'elles soient publiques, privées ou mixtes. Au sein de l'entreprise, les travailleurs et les techniciens forment la section syndicale, qui est dirigée par les agents de liaison syndicale et les membres assermentés. Pour leur action dans l'entreprise, les agents de liaison et les porte-parole peuvent élire des délégués, qui sont les représentants les plus concrets des travailleurs. Les agents de liaison interviennent dans toute entreprise de plus de cinq travailleurs. Leur nombre varie en fonction de la taille de l'entreprise. De leur côté, les porte-parole assermentés étaient des agents de liaison qualifiés dans les grandes entreprises - celles qui comptaient plus de 50 employés permanents. Phalangistes et policiers collaboraient pour s’assurer que les personnes considérées comme « subversives » ne soient pas candidates aux postes d’agents de liaison. Ils menaçaient et parfois battaient les récalcitrants.
ORB