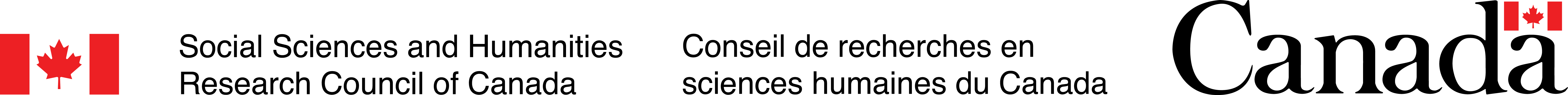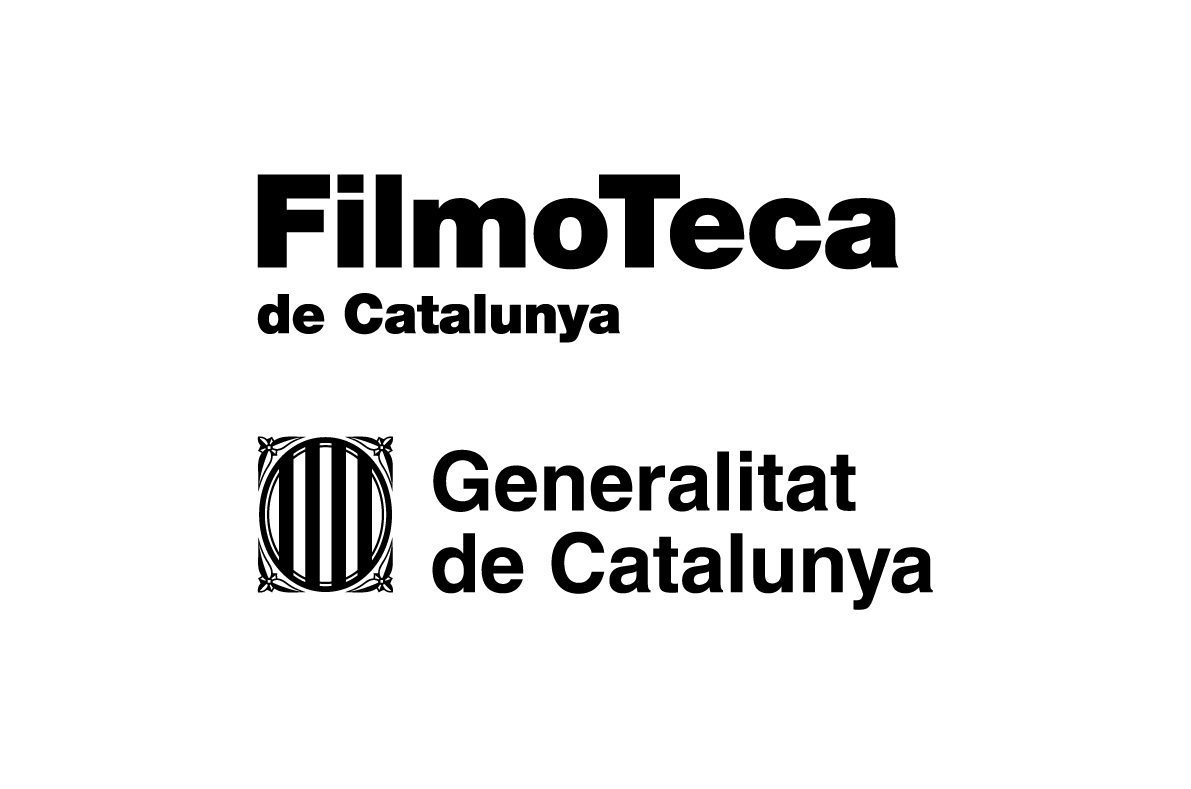Brassard de guérilla
Ce brassard a appartenu à un membre de l'Armée de guérilla de Galice, l’une des unités irrégulières qui ont mené la résistance armée au régime franquiste jusqu'en 1952. Entre 10 000 et 12 000 partisans ont participé à cette lutte, dont les principaux foyers se situaient en Galice et dans les Asturies, à León, en Estrémadure et en Nouvelle-Castille, à Grenade et à Malaga, ainsi qu’à Cuenca, Teruel et Castellón.
L'échec du coup d'État, la guerre elle-même et la violence des rebelles ont été les éléments qui ont généré la résistance de la guérilla républicaine, dont les origines remontent à l'été 1936, et qui s’est poursuivie après la fin de la Guerre Civile, n'étant complètement vaincue qu'en 1952.
L'histoire de la guérilla antifranquiste s'inscrit dans le contexte européen de la Seconde Guerre mondiale, où les mouvements de résistance armée étaient la réponse à l'occupation et au collaborationnisme local. L'une des grandes différences entre la résistance républicaine et le reste de la résistance européenne réside dans le fait que les expériences européennes ont pu revendiquer la victoire sur le fascisme, même si leur contribution et leur efficacité militaire réelle ont été très variables. Pendant ce temps, les Républicains espagnols ont été vaincus tant dans la guerre régulière que dans la guerre irrégulière.
Néanmoins, il existe des liens évidents. L'Armée populaire de la République a utilisé des unités de guérilla, et certains de ses membres ont même fini par commander des unités de partisans dans d’autres pays, notamment en France, mais aussi plus loin, sur le front de l'Est ou en Yougoslavie. En outre, des centaines de groupes de guérilla ont été créés et ont opéré indépendamment de l'Armée populaire entre 1936 et 1939.
Après la défaite finale de l'Armée républicaine en 1939, les partisans ne se sont pas battus pour prendre une ville, ni pour vaincre les forces franquistes, mais surtout pour survivre dans l'attente d'événements tel que l'invasion de l'Espagne par les Alliés, qui n’a jamais eu lieu. Dans les années 1940, le Parti communiste espagnol a structuré des groupes de guérilla et a envoyé des militants de France pour les commander. Bien que cela ait changé leur façon d'aborder le combat, professionnalisé de nombreux groupes et leur ait permis de maintenir leur existence plus longtemps, les guérillas étaient vouées à l'échec.
L'asymétrie entre les acteurs de la guérilla et ceux de la contre-insurrection se caractérise généralement par le fait que ces derniers disposent d'une série de ressources que les premiers n'ont généralement pas, comme ce fut le cas en Espagne : un gouvernement établi bénéficiant d’une reconnaissance diplomatique ; des ressources financières, industrielles et agricoles plus importantes ; la gestion et l'entretien des réseaux de transport et de communication ou le contrôle de l'information, entre autres. C'est pourquoi les forces chargées de la contre-insurrection n'ont pas passé plus de quinze ans à se battre dans les montagnes pour prendre le contrôle du territoire aux partisans, car de facto ils ne contrôlaient rien, mais cherchaient plutôt à les éliminer physiquement ou à les harceler pour que, épuisés, ils finissent par s'exiler. En chemin, quelque 2 000 guérilleros ont été tués et plus de 3 000 arrêtés.
AFP