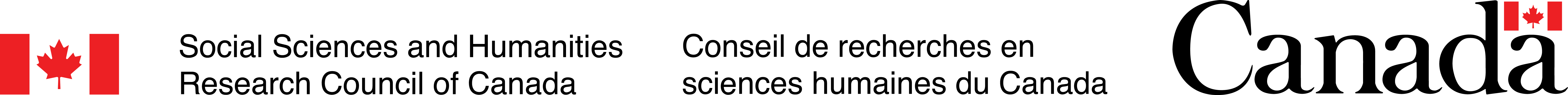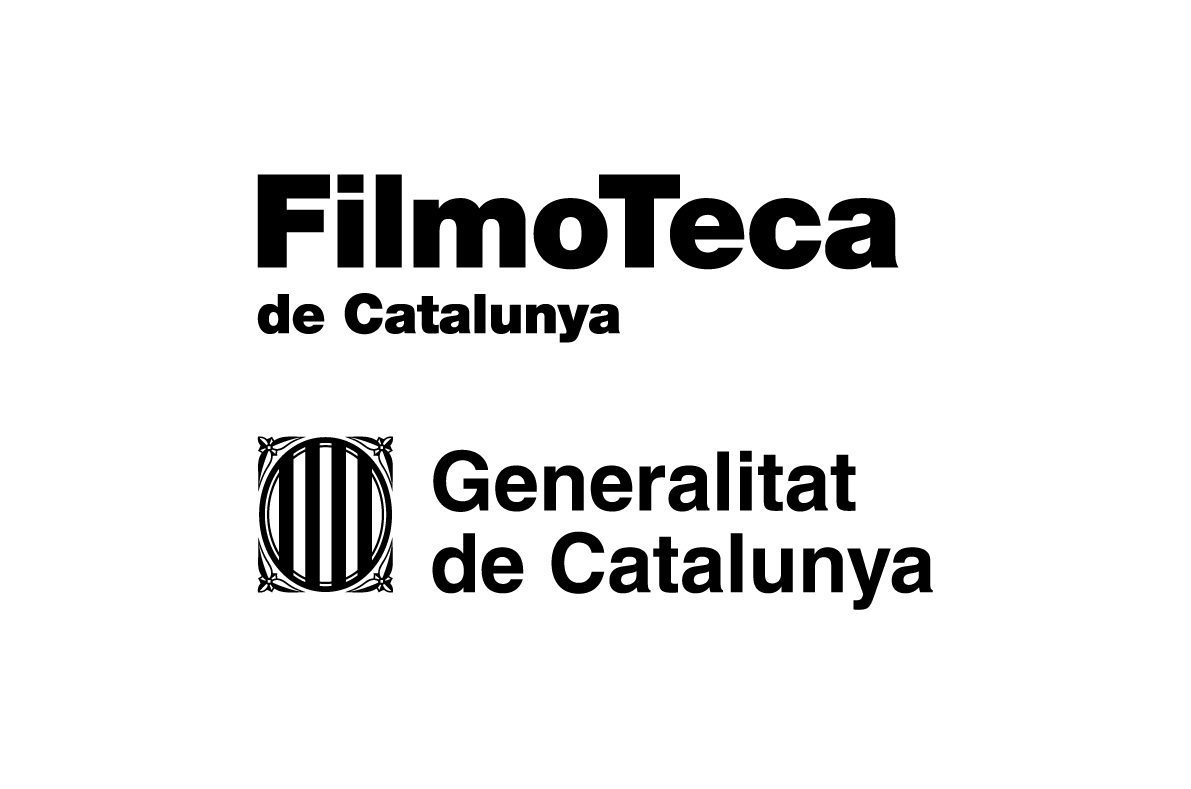Le domaine andalou
Creator: Consejo Superior de Cámaras Agrícolas
Source:
Mediateca del Ministerio de Agricultura y Pesca, https://www.youtube.com/watch?v=HqggoTIB3K8
Date Created: 1945
Extent: 1 item
Le franquisme a présenté ses politiques socio-économiques comme la solution définitive aux maux séculaires de l'Espagne. Ce discours s’est d’abord attaché à justifier la rébellion de juillet 1936 à partir du désordre existant et de la fausse menace d'une révolution imminente. Le nouveau régime promettait un présent d'ordre et un avenir de progrès. Réalisée pour les syndicats ruraux franquistes (Conseil supérieur des chambres agricoles), la vidéo reproduite ici montre l’image idéale d’un “Cortijo” (un domaine) andalou en 1945, comme un « château de paix et de travail », au plus fort de la faim et du désespoir de la paysannerie espagnole pauvre.
Dans ce contexte, la propagande franquiste tente de justifier la contre-réforme agraire. Ce n'était pas facile. Tant la rébellion militaire que l'avancée sanglante de ses troupes rebelles dans le sud du pays ont eu pour but d'écraser la réforme agraire républicaine qui, au cours des cinq mois précédant le coup d'État militaire, avait abouti à l'occupation, légalisée par le gouvernement, de plus d'un demi-million d'hectares, et qui, pendant le déroulement de la guerre, s’était traduite par la prise, et souvent la socialisation, d'au moins cinq millions d'hectares supplémentaires.
L'anéantissement de ce mouvement paysan a impliqué beaucoup de propriétaires terriens qui ont pris la tête de colonnes de phalangistes et d'autres volontaires de droite, ainsi que de soldats et de policiers. Ils occupent les villages et, après avoir assassiné les dirigeants politiques et syndicaux, rétablissent la structure de la propriété qui existait avant 1936, et même avant les réformes républicaines en 1932. Les principales zones de colonisation et d'irrigation du régime, l'Estrémadure et l'Andalousie occidentale, sont aussi celles qui ont le plus souffert de cette répression.
Les réformes sociales dans les campagnes sous le régime franquiste étaient centrées sur la colonisation agraire menée par l'Institut National de Colonisation depuis sa création en 1939. Ses résultats ont été très médiocres. En 40 ans, seules 40 000 familles ont été installées dans 30 000 maisons réparties dans près de 300 villages et hameaux. Près d'un quart de ces colons étaient de simples ouvriers agricoles, qui disposaient de petites parcelles familiales d'un demi-hectare.
En réalité, le régime ne s'intéressait qu'à augmenter la production agricole et à fixer certains paysans à la terre. Le reste, soit des millions de personnes, était excédentaire. La colonisation a aidé ces derniers, mais l'essentiel des investissements de l'État a été consacré aux premiers. Les grands projets d'irrigation, basés sur la construction de nouveaux barrages et de canaux, visaient à aider les grands propriétaires qui voyaient leurs terres revalorisées grâce aux investissements publics. La position des grands propriétaires terriens a également été favorisée par la politique du régime de prix agricoles élevés et de bas salaires, qui n'ont retrouvé qu'en 1962 le pouvoir d'achat qu'ils avaient en 1936. Pour les masses journalières et la petite paysannerie affamées et réprimées, l'avenir était écrit : émigrer pour échapper à la misère, vers d'autres pays comme la France ou l'Allemagne ou vers les grandes villes du pays.